
TARAWA SUD, Kiribati, le 21 octobre 2025 – Partout dans le monde, les sociétés sont confrontées à une question récurrente : pourquoi les changements sociaux significatifs sont-ils souvent difficiles à mettre en œuvre, même lorsque des politiques sont en place et que les bonnes intentions abondent ? Au Kiribati, cette question revêt une urgence particulière en ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes.
« Les politiques nationales ne suffisent pas à elles seules », a déclaré Quddus Akura Terubentau, du Bureau des affaires extérieures des bahá’ís de Kiribati, lors d’un entretien avec le News Service.
« Bien que le pays ait adopté l’égalité entre les hommes et les femmes au niveau national, les normes culturelles et familiales persistent d’une manière qui entrave sa pleine réalisation », a-t-il expliqué.
M. Terubentau a ajouté : « La voie à suivre nécessite une double approche : renforcer les initiatives locales pour surmonter les barrières culturelles et veiller à ce que les efforts déployés au niveau national soient intégrés de manière significative dans les contextes locaux. »

Cet écart persistant entre la politique et la pratique a incité le Bureau à engager un dialogue continu avec des représentants du gouvernement, des dirigeants de la société civile et des technologues pour étudier comment les familles peuvent favoriser des environnements propices au bien-être de tous leurs membres dans un monde en mutation rapide.
Un forum de discussion, récemment organisé par le Bureau des affaires extérieures, a permis de réunir certains de leurs points de vue.
Barrières culturelles et familiales
Le débat a porté sur les différentes pressions qui pèsent sur la vie familiale. Beta Turpin, députée à la retraite, a fait remarquer que lorsque les parents ont recours à des méthodes disciplinaires autoritaires, ou lorsque les nombreuses contraintes concurrentes qui pèsent sur le temps des familles laissent moins de place à des du relations significatives avec les enfants, il peut devenir difficile de cultiver l’égalité et le respect mutuel au sein foyer.
Kanaan Ngutu, spécialiste en technologies de l’information, a souligné les nouvelles pressions auxquelles sont confrontées les familles à une époque de changements technologiques rapides. « Les réseaux sociaux influencent les enfants d’une manière qui normalise parfois des comportements autrefois considérés comme inappropriés », a-t-il observé.
« Les parents sont souvent distraits par le travail ou par leurs propres appareils électroniques ; ils sont moins présents pour guider leurs enfants », a précisé M. Ngutu.
Il a toutefois souligné que la solution ne consistait pas à rejeter la technologie. « Les enfants ne doivent pas être privés des possibilités offertes par la technologie, mais ils doivent être soutenus, accompagnés et guidés pour qu’ils s’épanouissent grâce à elle. »
De nombreuses familles se retrouvent à adopter des comportements qui, à la réflexion, leur apparaissent comme néfastes. Mais sans possibilité de réflexion, les gens ne peuvent pas voir comment certaines normes contribuent à des problème plus vastes. C’est là que les espaces de dialogue constructif prennent toute leur importance.
Quddus Akura Terubentau, Bureau des affaires extérieures de Kiribati
Rusila Tekamotiata, responsable du programme Égalité des sexes à la Haute Commission australienne au Kiribati, a souligné un obstacle auquel sont confrontées de nombreuses sociétés. « Au sein des familles, les femmes, en particulier les femmes âgées, sont parfois les plus ferventes à défendre la domination masculine traditionnelle », a-t-elle déclaré.
Elle a ajouté : « Pour qu’un changement significatif prenne racine, la transformation doit commencer chez soi. »
« De nombreuses familles se rendent compte qu’elles ont des schémas d’habitudes qu’ils reconnaissent, après réflexion, comme dangereuses », a ajouté M. Terubentau.
« Mais sans opportunités pour la réflexion, les gens ne se rendraient pas compte comment certaines habitudes contribuent aux défis plus larges. C’est là que des espaces pour un dialogue réfléchi deviennent si important. »
Une question d’autorité et de noblesse
La consultation a abordé des questions plus profondes : quelles conditions permettent aux gens d’apporter un véritable changement dans leur vie et dans leur communauté, et pourquoi ce changement peut-il parfois s’avérer si difficile, même lorsque son importance est comprise ?
« Dans de nombreuses sociétés, on part souvent du principe que le changement doit être motivé par des pressions extérieures, explique M. Terubentau. On retrouve ce schéma dans différentes institutions, que ce soit sous forme de sanctions légales, de sanctions sociales ou de menace d’exclusion de la communauté. Ces approches s’appuient toutes sur l’autorité pour imposer un comportement. »
Le problème sous-jacent, suggère-t-il, réside dans une vision limitée des capacités humaines. « Cette façon de penser part du principe que les gens ne peuvent pas changer parce qu’ils ne sont pas perçus comme des êtres nobles. Or, ce sont des êtres spirituels dotés d’une nature supérieure qui peut les aider à transcender leurs limites. »
Ce changement – passer d’une vision des personnes comme ayant besoin d’un contrôle externe à la reconnaissance de leur noblesse inhérente – redéfinit la manière dont les institutions interagissent avec les communautés et les individus.
« Lorsque nous considérons les gens comme des êtres nobles, la communication change. Le respect s’installe, car les institutions s’adressent à des âmes nobles », déclare M. Terubentau.
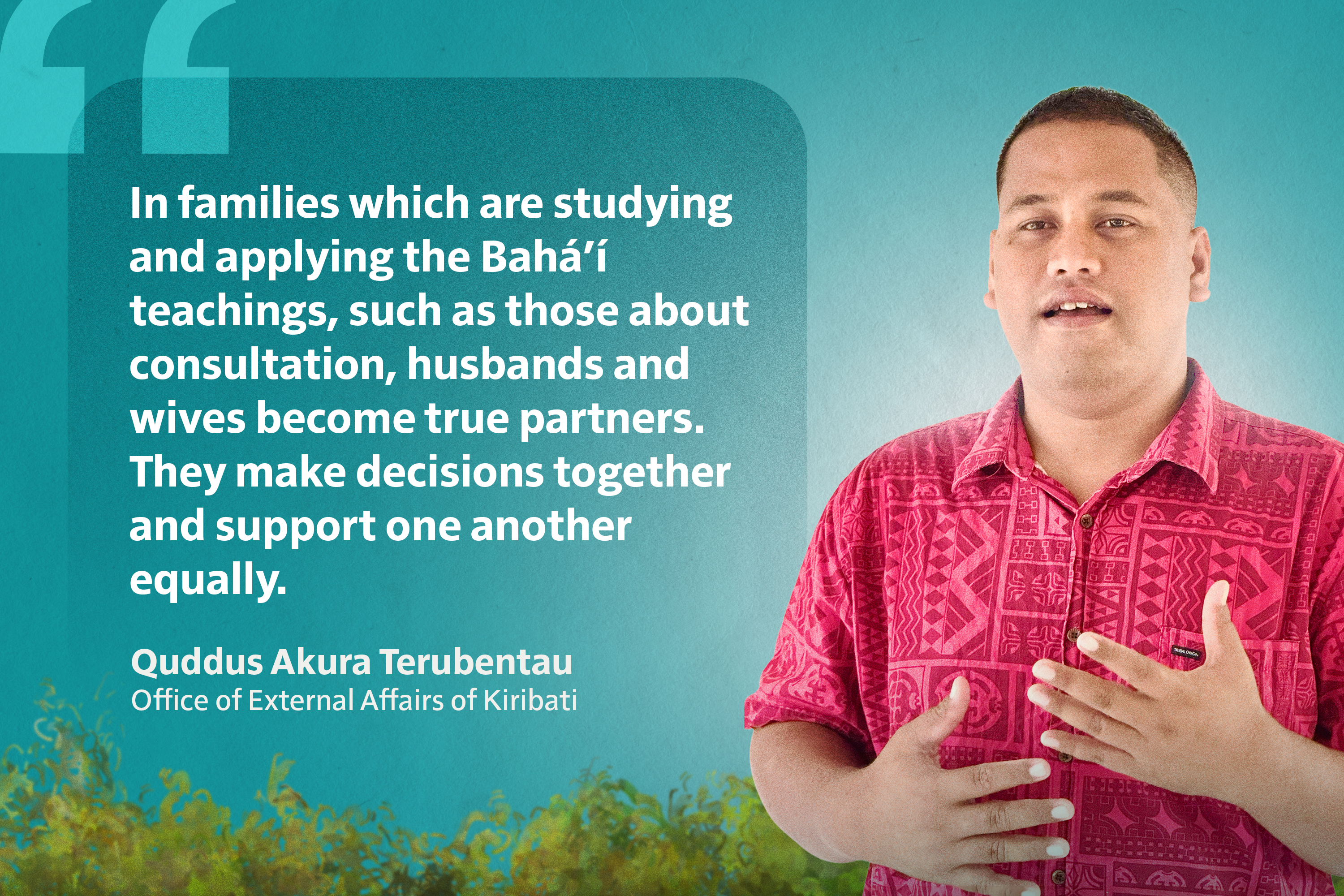
Quddus Akura Terubentau, Bureau des affaires extérieures de Kiribati
Aperçus du changement
Le Bureau constate que cette conception se reflète dans les quartiers où les activités bahá’íes de développement des communautés sont florissantes. Les familles apprennent à se concerter, non par le débat, mais par l’écoute respectueuse. Dans un tel processus, la voix des enfants est prise en compte, les hommes partagent des responsabilités autrefois considérées comme relevant du rôle des femmes, et les divisions rigides cèdent la place à la coopération.
« Nos efforts sont modestes, mais nous assistons à un changement, indique M. Terubentau. Dans les familles qui étudient et appliquent les enseignements bahá’ís, tels que ceux concernant la consultation, maris et femmes deviennent de véritables partenaires. Ils prennent des décisions ensemble et se soutiennent mutuellement.
« Ces modèles influencent également l’esprit de service au-delà du foyer. De nombreux couples s’engagent ensemble dans des activités visant à améliorer la société, remettant ainsi en question la norme selon laquelle les femmes doivent se limiter à la vie domestique. Lorsque ce partenariat existe, les cas de violence sont nettement moins fréquents, voire inexistants.
« Lorsque les époux discutent ensemble des objectifs de leur famille, de la manière de collaborer et d’intégrer les opinions de leurs enfants, ils créent l’unité. »

Grâce à des consultations régulières, les familles réfléchissent à leurs progrès, partagent les défis et identifient des moyens de se soutenir mutuellement.
« Chaque personne apporte un point de vue unique Lorsque ceux-ci sont harmonisés, y compris ceux des enfants, la famille devient plus forte. »
La participation aux programmes bahá’ís d’éducation morale et spirituelle renforce ces habitudes.
En apprenant à écouter, à faire preuve d’empathie et à collaborer, les personnes transposent ces capacités dans leur vie familiale, sur leur lieu de travail et, finalement, dans la société, ce qui rend l’expérience plus unifiée et plus utile.
Une voie à suivre
Les expériences émergentes issues des efforts de renforcement communautaire et des débats nationaux avec les acteurs sociaux offrent un aperçu de la manière dont un changement durable peut se produire.
« Les politiques sont importantes, mais elles ne peuvent pas se substituer à l’apprentissage au sein des familles et des communautés. » Cet apprentissage, fondé sur la reconnaissance de la noblesse de chaque personne, révèle comment l’autorité peut être repensée.
« De ce point de vue, la véritable autorité ne réside pas dans le contrôle, mais dans la promotion de la confiance, de la réflexion et de la coopération », déclare M. Terubentau.
